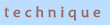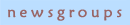| Recherche |
|
Effectuée par freefind.com |
| Nouveautés |
| Dernières Fiches |
Messerschmitt Bf 109 |
| Menu |
| Sous-Menu |
| fr.rec.aviation |
| Loana |
| Ciel et Partage |
| Best-of des récits par Léon |
|||
|
Lors de notre arrivée à Sidi Bel Abbès nous fûmes logés dans une école réquisitionnée par l'armée. Cet établissement était situé à proximité de la caserne de la légion étrangère. En plus de nos activités habituelles nous eûmes à construire une cible de bombardement, à usage d'entraînement, pour les équipages du groupe auquel nous étions attachés. Nous construisions cette cible dans les environs de Bedeau, une petite localité située à 100 km au Sud de Sidi Bel Abbès. Pour transporter le personnel sur place nous disposions de deux camionnettes Matford V8 (1) de 2,5 tonnes. Je conduisais l'une de ces voitures, tandis qu'un camarade emmenait avec lui, dans l'autre véhicule, le lieutenant qui commandait notre détachement. Avec ma camionnette je remorquais une petite citerne, datant des années vingt, dotée de roues à bandages pleins, destinée à transporter l'eau nécessaire à notre subsistance. Le voyage aller se passa sans problème, mais lors du retour le lieutenant me dit : « Votre véhicule étant en meilleur état que le mien il est préférable que je passe devant et que vous me suiviez ». Sitôt dit sitôt fait et nous prenons la route de Bel Abbès. Le lieutenant étant un pied-noir originaire de la région nous nous arrêtions dans nombre de villages où nous étions invités à boire un verre. Après le dernier village je suivais toujours la voiture du lieutenant mais, à un moment donné, je la perdis de vue. Pensant qu'elle avait pris de l'avance sur moi j'accélérai jusqu'à environ 120 km/h. Cela sur une route en mauvais état et avec ma vieille remorque qui se balançait sans cesse d'un bord à l'autre. Mais, à l'horizon, toujours pas de voiture en vue. Je continuai donc seul jusqu'à Bel¬-Abbès. A mon arrivée à notre cantonnement, alors que je racontais mes aventures aux camarades, un adjudant chef nommé Bourichon, qui n'était pas un ami, fit irruption dans la pièce. Il dit avoir entendu mes propos et aller, de ce pas, les rapporter au colonel. Effectivement, quelques minutes plus tard, j'étais convoqué au bureau du colonel. Ce dernier me tint le discours suivant : " Léon vous avez enfreint la note de service qui enjoignait au personnel de ménager le matériel français en attendant l'arrivée du matériel américain. Je suis dans l'obligation de vous punir. Vous aurez 15 jours d'arrêts de rigueur ". J'eus beau lui expliquer ce qui s'était passé, il ne voulut rien entendre et me rétorqua que le lieutenant, qui connaissait bien la région, avait pris un raccourci. Comme ce n'était pas impossible il m'était difficile de contester quoi que ce soit. Je partis donc faire mes quinze jours. Notre cantonnement étant, évidemment, dépourvu de locaux disciplinaires, on m'envoya purger ma peine à la légion étrangère. En pénétrant dans la cour des casernements de la légion je vis d'abord l'imposant monument représentant un globe terrestre porté par des légionnaires (2) puis, ensuite, je fis connaissance avec les prisons. Celles ci étaient constituées d'une suite de cellules donnant sur une cour murée de tous côtés. Ma cellule, éclairée par une petite fenêtre munie de barreaux, était meublée d'un lit et d'une table avec chaise. Le responsable des prisons était un adjudant d'origine allemande, une sorte de colosse qui dirigeait ses pensionnaires d'une main de fer. Il ne demandait qu'une chose : que les prisonniers s'abstiennent de lui créer des ennuis. Comme c'était mon cas nos relations furent cordiales. Pour les sous officiers aux arrêts le service des repas était assuré par un prisonnier allemand de la guerre de Tunisie. Celui ci était heureux d'avoir sauvé sa peau et d'avoir trouvé une bonne planque. Midi et soir il m'apportait des repas dont il avait pris livraison au mess des sous officiers. La nourriture, abondante et de bonne qualité, était accompagnée d'un bidon de vin. Je me sentais parfaitement heureux. Mon emploi du temps était le suivant : Réveil à 7 heures – café – toilette promenade dans la cour lecture de l'Echo d'Oran 12 heures, repas. Sieste de 13 à 15 heures promenade dans la cour – lecture 19 heures, repas – lecture 21 heures, extinction des feux. Les 15 jours étaient passés et mon chef direct étant absent personne ne vint me chercher. Je m'en réjouissais quand, au bout de vingt jours, Bourichon, malheureusement, pensa à moi. Je dus retourner à mon unité (3). Il me fut rapporté par la suite que Bourichon se serait plaint, au colonel, du régime très libéral dont j'avais, selon lui, bénéficié à la légion étrangère. Il aurait étayé son point de vue en prétendant que j'étais revenu de là bas en meilleur état de santé que lors de mon départ. Selon la rumeur publique le colonel l'aurait éconduit. (1) Fusion, avant guerre, des usines Ford et Mathis. (2) Monument actuellement dans la cour du quartier Vienot, à Aubagne. (3) Je n'en étais pas heureux parce que, fatigué des camions et des citernes, je voulais reprendre une activité purement aéronautique. |
|||
faq-fra.aviatechno.net © 2001-2026